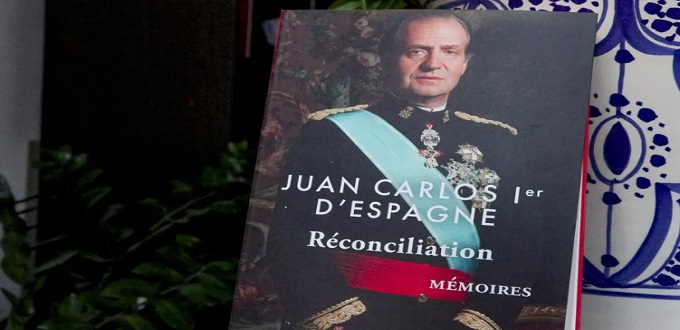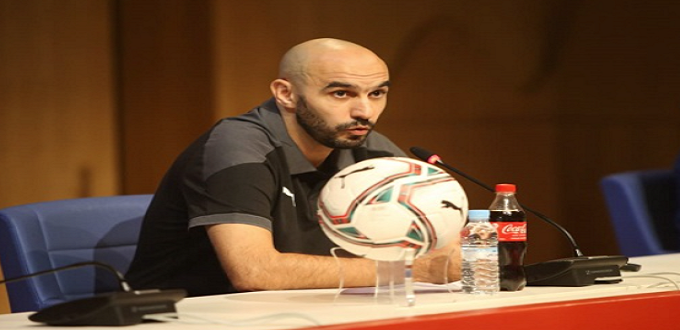Mémoire confisquée, histoire verrouillée :l’historien marocain face aux silences d’Espagne

Il y a des vérités que l’on garde sciemment sous clé. Des documents classés, non parce qu’ils sont obsolètes, mais parce qu’ils révèlent trop. Au croisement des intérêts d’État et des silences diplomatiques, l’histoire devient enjeu de pouvoir. Le 27 juillet 2024, le journal El País a publié un article révélateur sur le verrouillage persistant des archives espagnoles, notamment celles liées à l’époque franquiste et aux accords discrets passés avec les États-Unis. Sous couvert de sécurité nationale, la loi espagnole permet encore aujourd’hui de classer certains dossiers sensibles pour une durée allant jusqu’à un siècle. Derrière cette opacité, se profilent des récits inachevés, dont certains concernent directement le Maroc.
Car les archives verrouillées de l’Espagne ne renferment pas seulement la mémoire de l’Espagne : elles contiennent aussi des fragments précieux de la mémoire marocaine. Elles touchent aux zones d’ombre du protectorat espagnol, aux résistances populaires du nord, aux stratégies coloniales dans le Rif, aux arrangements secrets dans les provinces du Sud. Ce sont des morceaux d’histoire arrachés au territoire national, enfermés dans des armoires à Madrid ou Tolède. Et leur non-accès constitue un prolongement symbolique de la dépossession.
Le chercheur marocain, qui cherche à comprendre ces pages occultées, se heurte encore à des refus, des lenteurs, des autorisations temporisées. Ce blocage ne concerne pas seulement la science : il touche à la souveraineté mémorielle d’un peuple. Car l’histoire du Maroc ne saurait être écrite à moitié, ni dictée par ce que d’autres veulent bien livrer. Le passé colonial, dans toutes ses dimensions, appartient aussi à ceux qui l’ont subi, affronté, transformé en lutte pour la dignité.
Ce que révèle la persistance de ces archives fermées, c’est une géopolitique de l’histoire. Une hiérarchie implicite entre les récits européens « légitimes » et les mémoires périphériques, souvent jugées secondaires. Or, pour un historien marocain conscient de son rôle, il n’est plus possible d’accepter cette asymétrie. L’héritage colonial espagnol au Maroc ne peut être raconté qu’en croisant les voix. Et surtout, en rendant la parole aux silences marocains trop longtemps réduits à des notes de bas de page.
Derrière chaque document encore classé, il y a peut-être une lettre d’un caïd, un rapport sur une insurrection rifaine, un échange entre le haut commandement espagnol et des agents locaux. Il y a de quoi redonner chair à des figures historiques restées dans l’ombre. C’est aussi un moyen de démontrer que le Maroc n’a jamais été une terre passive, mais un espace d’agitation intellectuelle, de résistance farouche, d’alliances stratégiques et de conscience politique vive, y compris en période de domination étrangère.
À l’heure où le Maroc affirme de plus en plus sa place dans les dynamiques régionales et internationales, il est vital que son histoire soit racontée de manière complète, souveraine, et assumée. Le refus de certains États de dévoiler les archives les concernant n’est pas un simple geste bureaucratique : c’est une manière de contrôler le récit. Et ce contrôle, en soi, est une continuation du passé colonial.
C’est pourquoi l’historien d’aujourd’hui ne peut plus se contenter d’être un archiviste des puissants. Il doit devenir un veilleur de mémoire, un constructeur de sens, un artisan de justice épistémologique. Être historien au XXIe siècle, surtout dans un pays comme le Maroc, ce n’est pas seulement produire du savoir : c’est revendiquer le droit d’écrire son histoire par soi-même, pour soi-même, avec les outils de la rigueur scientifique, mais aussi avec la conviction intime que l’histoire nationale ne peut être confiée à d’autres.
Cette fidélité à la profondeur historique de son pays, cette exigence de vérité enracinée, n’est pas repli mais affirmation : une manière d’assumer que l’indépendance politique sans souveraineté narrative reste incomplète. C’est aussi une manière de rendre hommage à toutes celles et ceux – connus ou anonymes – qui ont forgé dans l’adversité le fil d’une histoire marocaine fière, combattante, et profondément attachée à sa terre, à sa langue et à sa dignité.
Par Omar Lamghibchi